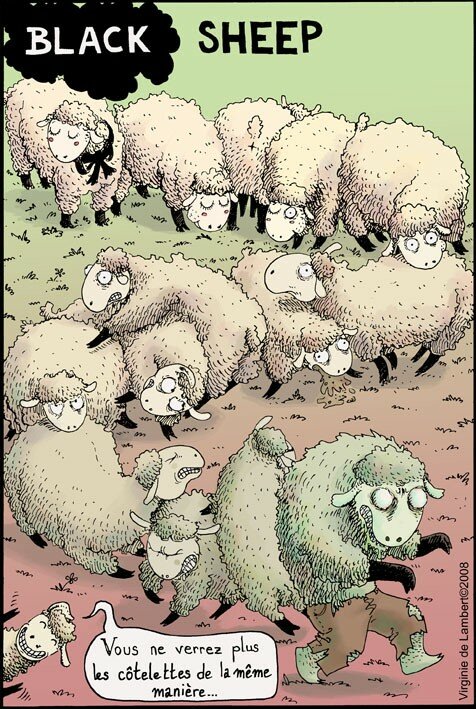BLADE RUNNER de Ridley SCOTT - 1982 - Etats-Unis
Episode III : "I want more life, fucker!"
That's what it is to be a human being?
En 1992, j'ai quatorze ans, je connais Blade Runner par coeur et pourtant, je ne l'ai jamais vu...
Mais c'est un film-culte, un vrai, et un film-référence, un maître-étalon que les critiques et théoriciens que je dévore citent allègrement. Rongeant mon frein dans l'attente d'une hypothétique diffusion télé, je lis la nouvelle Les Androïdes Rêvent-ils de Moutons Electriques de Philip K. Dick dont il s'inspire, Blade Runner étant au passage, de concert avec Total Recall (Verhoeven), Planète Hurlante (Duguay), Minority Report (Spielberg) et A Scanner Darkly (Linklater), une des meilleures adaptations du maître de la S.F. Et voilà que Ridley Scott et la Warner décident de sortir en salles le nouveau Director's Cut ( qui marque le dixième anniversaire du film et fait suite aux deux premières versions sorties initialement en 1982, l'une internationale, l'autre réservée aux Etats-Unis; Scott, mécontent de ce remontage, en élabore un autre, qu'il promet définitif, en 2007; ces quatre versions, passionnantes à comparer, sont réunies, avec en sus une copie de travail rarissime (et donc une cinquième version!) dans le coffret paru aux dernières fêtes, en prêt gratuit chez Clyde pour tout les veinards qui ajoutent au privilège d'être nos lecteurs, l'honneur de pouvoir se compter parmi nos amis dignes de confiance). Cette projection, dans une petite salle pourrave et quasi déserte de l'UGC Part-Dieu Niveau 4 sera un événement-clé dans ma construction de cinéphile, avec le premier visionnage de 2001 : L'Odyssée de l'Espace, puis le énième mais pour la première fois dans une vraie grande salle de cinéma (LA grande claque de ma vie, LA crampe esthétique ultime...), ou les expériences extrêmes que furent Pi et Requiem for a Dream (Darren Aronofsky)( Bonnie se souvient bien de ce dernier, aussi, cuisinez-la...!), Sombre (Philippe Grandrieux), Seul Contre Tous (Gaspard Noé), Saló et L'Evangile Selon Saint Matthieu (Pasolini), Bullet Ballet (Tsukamoto), Arrête ou Ma Mère Va Tirer (avec Stallone) ou j'irai Verser du Nuoc Mam sur Tes Tripes (Chu Mu)...
Du coup, c'est pas évident de pondre un texte sur un film aussi important, pour les autres, beaucoup d'autres, et pour soi, surtout soi. Je suis le premier que je ne veux pas décevoir. C'est pourquoi, après de longues tergiversations que matérialisèrent (?) les dizaines de brouillon virtuels répandus sur le fond d'écran pixelisé de mon bureau électronique, je me suis résolu à aborder ce film par le seul angle dont je garantisse l'originalité : le mien, en partant de ce qui est, sinon la qualité numéro un du film, en tout cas la première à m'avoir touché, c'est-à-dire sa capacité d'immersion totale du spectateur, qui n'en demandait pas tant (si, en fait! C'est pire qu'une drogue!), dans son univers unique.
Pour moi, Blade Runner fait partie de ces films qui réussissent à s'affranchir des limites imposées par leurs supports de diffusion (le fantôme blafard de l'écran de cinéma, le pullulement épileptique de celui de la télé ), à transcender ce que l'on peut considérer comme l'une des limites du 7ème art : en tant que projection frontale d'images qui défilent, un film reste toujours consciemment, pour le spectateur, une représentation du réel et, conséquemment, une fiction.
Or Blade Runner réussit à s'extraire de sa prison pour venir déborder sur la réalité du public : feu d'artifice visuel d'une splendeur si pleine de subtilités que son esthétique en est devenue instantanément culte et indémodable, ses étincelles et autres flammèches s'éparpillent au gré du souffle lyrique qui parcourt le métrage, pour venir mourir aux pieds des spectateurs en boutant un incendie ravageur pour sa réalité. Néo-film noir aux accents existentiels et métaphysiques (qui ne sont pas sans évoquer l'un de mes chouchous nippons : Mamoru Oshii) de plus en plus appuyés au fur et à mesure que l'on plonge, pour l'explorer, dans cette labyrinthique et cauchemardesque mais fascinante mégalopole du futur, géniale métaphore de la psychologie (de l'âme?) complexe, contrastée et mystérieuse des différents protagonistes, (on respire et on reste concentré, je vous signale que la phrase n'est pas vraiment commencée, c'était que la pitite apposition introductive! Les Baroques auront toujours ma préférence sur les Classiques...), le chef-d'oeuvre de Ridley Scott est bien évidemment aussi l'une des pierres angulaires de la Science-Fiction cinématographique et du courant Cyber Punk.
Sa tonalité singulière, c'est le Graal de ce film : le calice où sont recueillies les gouttes d'âme que les personnages perdent par leurs blessures morales, psychologiques et physiques, et où se mélangent le masque cynique de Deckard, la naïveté romantique de Rachael, l'espoir, qu'anéantit l'angoisse, de Roy, Pris ou Léon et même Sebastian... Le cocktail, puissant, est en parfaite adéquation avec les grandes orientations de la photographie, le rythme narratif ainsi que l'architecture scénaristique et achève de faire du film une plongée en apnée dans les tréfonds d'une ville, dans les tréfonds d'une société, dans les tréfonds de l'Homme, recoins inconfortables et sombres, mais d'où jaillit, toujours, in extremis, la lumière, l'humanité. L'extraordinaire scène de la mort de Roy, le personnage qui offrit à Rutger Hauer l'une de ses interprétations les plus bouleversantes, et surtout son monologue dit de « Tears in the rain », semble nous dire que l'on n'est humain que lorsque on se comporte en tant que tel; partant, certains hommes n'ont rien d'humain, et « être humain » est accessible au-delà de l'humanité. En tout état de cause, être humain, c'est un travail.